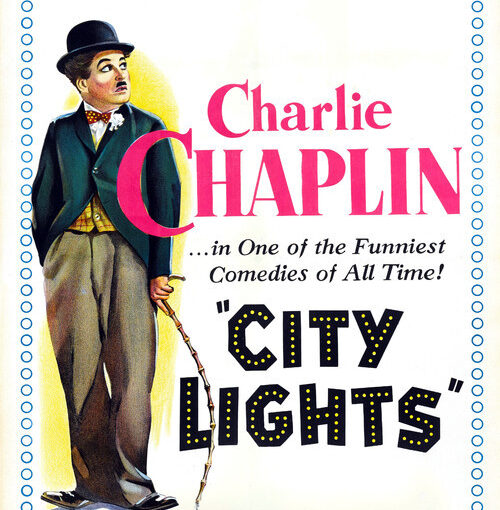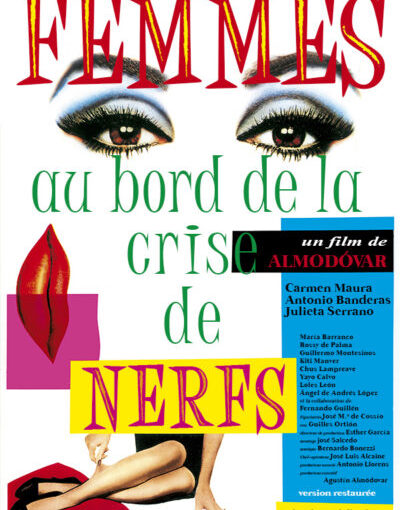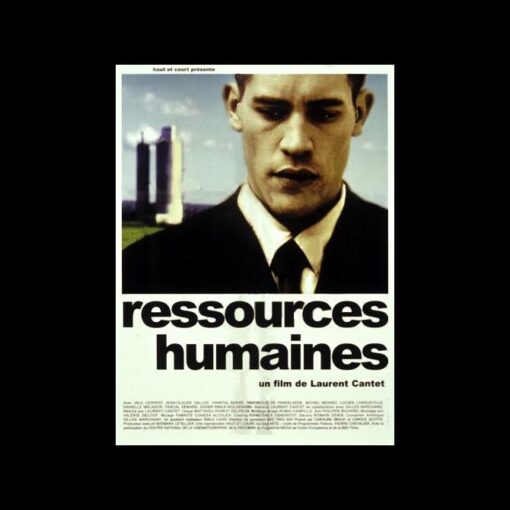Film de Martin Scorsese (2010)
En 1494, Sébastien Brant publie La Nef des fous, composition littéraire d’un genre nouveau et appelé à un grand succès (le motif est repris en peinture par Jérôme Bosch quelques années plus tard) pour sa portée satirique, sorte de miroir tendu à une époque : à bord d’un vaisseau, un équipage « de héros imaginaires, de modèles éthiques ou de types sociaux s’embarque pour un grand voyage symbolique qui leur apporte sinon la fortune, du moins, la figure de leur destin ou de leur vérité » (1). De la même façon, un certain cinéma américain (2) utilise la folie pour discourir sur l’incommunicabilité, l’enfermement et pour creuser le sillon de la critique politique et sociale, l’institution psychiatrique et les traitements infligés aux aliénés (lobotomie, électrochocs, camisole chimique) révélant les failles de pays se considérant comme des démocraties. L’asile est alors envisagé comme une zone de non-droit ayant des similitudes plus ou moins lointaines avec le système concentrationnaire des régimes totalitaires. Mais c’est aussi le prétexte utilisé par le réalisateur, sans forcément s’arrêter sur la nature de la folie, pour montrer que la frontière entre la folie et la raison s’avère finalement très perméable, le fou (ou prétendu comme tel) se révélant détenteur d’une certaine vérité. Derrière son discours apparemment déraisonnable, se cache des vérités profondes que les sains d’esprit aimeraient bien continuer à cacher…
C’est à la croisée de ces deux héritages qu’il faut envisager le nouveau film de Martin Scorsese, un des « papes » du Nouvel Hollywood, devenu expert depuis les années 1970 dans la révélation de la face sombre de l’humanité ou, plus récemment, d’un système (voir Gangs of New York). C’est donc à bord d’un bateau que deux policiers, le marshal Teddy Daniels (Leonardo Di Caprio) et son coéquipier Chuck Aule (Mark Ruffalo), abordent Shutter Island, une île située au large de Boston accueillant un pénitencier psychiatrique, Ashecliff, pour dangereux criminels. Ils viennent enquêter sur la disparition très mystérieuse d’une patiente de l’institution. Au premier abord, le film lorgne du côté du policier classique, du genre Double assassinat dans la rue Morgue ou Le mystère de la chambre jaune, vu que nos fins limiers à qui on ne la refait pas, doivent résoudre une énigme qui relève de la quadrature du cercle : lors de sa disparition, la patiente était enfermée à double tour dans sa chambre-prison ! En clair, une vraie enquête pour apprenti Dupin ou néo-Rouletabille…
Sauf que très vite et, c’est une des qualités du film, tout se brouille et le spectateur, sans s’en rendre compte tout de suite, plonge dans la psyché du personnage principal, pas aussi sûr de lui qu’il en a l’air, pas aussi lisse qu’il voudrait le faire croire. Hanté par les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale (en tant que soldat américain, il a libéré le camp de Dachau, renvoyant à d’autres camps, plus contemporains ceux-là mais tout aussi condamnables) et miné par la mort assez violente de sa jeune épouse quelques années auparavant, il est sujet à de terribles maux de tête et fait, nuit après nuit, d’éprouvants cauchemars. On retrouve là un thème résolument scorsesien, celui d’un homme qui croit dominer le monde (en l’occurrence, résoudre une énigme apparemment insoluble alors que l’administration psychiatrique ne semble pas particulièrement désireuse de coopérer) et qui, plan après plan, séquence après séquence, s’effondre et découvre (ou redécouvre) sa propre vérité. A cet égard, Teddy Daniels n’est pas très éloigné de Travis Bickle, de Jack LaMotta, de Sam Ace Rothstein et autres Howard Hugues. Comme dans d’autres films du réalisateur américain, le spectateur ne peut que faire le constat en même temps que le héros de l’échec d’un homme qui ne parviendra pas à quitter Shutter Island.
Pour rendre compte de cette plongée dans les eaux troubles d’une âme humaine, Scorsese, entouré de ses fidèles techniciens (Thelma Schoonmaker la monteuse, Robert Richardson le chef op et Dante Ferretti le chef décorateur), se focalise sur les passages de plans objectifs à des plans subjectifs. « Un plan semble être montré d’un certain point de vue, puis le personnage entre dans ce plan qui devient un simple plan de lui, quitte à ce que l’on revienne ensuite à un plan subjectif » (3) Ce principe, exploré par Scorsese depuis le milieu des années 1990 (selon la monteuse) est au cœur du film, complique à dessein le point de vue et nous vaut de nombreuses scènes à l’onirisme très hitchcockien (4), teinté parfois de fantastique (assez inhabituel chez Scorsese) et un esthétisme, très appuyé dans certaines scènes mais parfois maladroit et critiquable (5).
L’esthétique du film repose aussi sur quelques motifs visuels exploités de façon récurrente. Le feu, les cendres, symboles de l’anéantissement, mais surtout l’eau. Elément du décor très important, motif visuel à la symbolique à la fois riche et ambivalente (6), l’eau est omniprésente et fait le lien entre de nombreuses scènes clés liées à la remontée de l’inconscient, au surgissement du refoulé. Elle décuple le potentiel d’angoisse (nombreuses allusions à la noyade) et d’oppression qui se dégage de cette île isolée, des lieux clos qui y sont présents (les différents pavillons de l’institution, les chambres-cellules, un phare énigmatique où se pratiqueraient d’inavouables tortures). Tout cela contribue à distiller dès le début du film une impression de danger et de mystère à la manière d’un récit gothique. La présence d’une forêt touffue et d’un cimetière, proches de l’institution, complètent d’ailleurs la panoplie des codes en usage dans ce type de productions littéraires et cinématographiques.
Enfin, et c’est habituel chez Scorsese, un soin tout particulier est accordé à la bande-son. Composée, entre autres, de morceaux de John Cage, de Ligeti ou de Penderecki, elle achève d’affilier Shutter Island à la famille des grands « films malades » de Stanley Kubrick à David Lynch, quelque part entre Eyes Wide Shut et INLAND EMPIRE.
Au final, ce film de Martin Scorsese est une sorte de thriller gothico-hitchcockien dans lequel, entre la folie et la raison, entre le rêve et la réalité, entre le temps présent et le passé, surgissent la crise de l’humain et l’effritement d’un système. Comme à l’automne du Moyen Age… Comme à l’époque où Sébastien Brant composait sa Nef des Fous…
Eric POPU
NOTES :
1. Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972.
2. Voir Shock Corridor de Samuel Fuller (1963) ou Vol au dessus d’un nid de coucou de Milos Forman (1975). On pourrait multiplier les exemples : à ce sujet, se reporter au dossier (très copieux) consacré par la revue Positif en juillet-août 2009 (n°581-582) à la folie au cinéma.
3. Propos de Thelma Schoonmaker recueillis par Nicolas Saada pour Les Cahiers du cinéma (n°500) et repris dans l’ouvrage de Thomas Sotinel consacré au réalisateur (publié en 2007).
4. Hitchcock est en effet cité à de nombreuses reprises dans le film. On y retrouve d’abord la présence du « macguffin » cher au maître (ici un message codé retrouvé par le policier dans la chambre de la disparue). Scorsese brode également sur les thèmes de la chute (de nombreuses falaises à pic découpent la côte de l’île), du dédoublement, du héros pris au piège de sa pathologie comme dans Les amants du Capricorne, La maison du Docteur Edwardes ou encore Vertigo.
5. On pense notamment aux scènes de remémoration de libération du camp de Dachau pour lesquelles, à deux reprises, le réalisateur n’hésite pas à utiliser le travelling renvoyant alors à la polémique suscitée au moment de la sortie de Kapo de Gilles Pontecorvo.
6. http://www.cafegeo.net/article.php3?id_article=70 (Article d’Alexandra Monot paru en 2003).