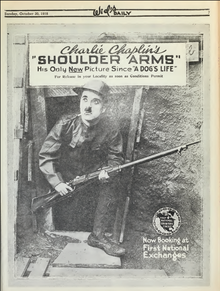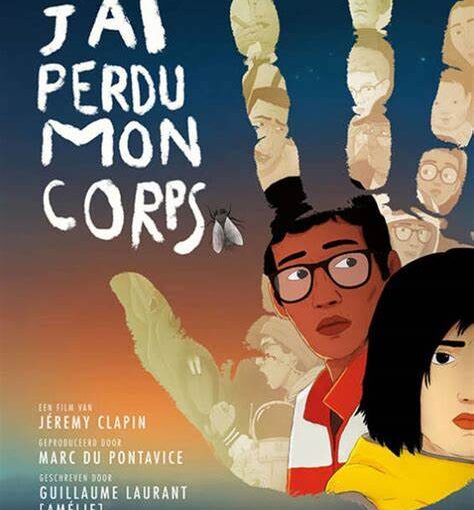Dans le cadre des « Semaines d’information sur la santé mentale » organisées au lycée, nous avons assisté à la projection du film Amour de Michael Haneke, suivie d’une intervention du docteur Robin. Cette rencontre a permis de mieux comprendre les thèmes du film sous un angle psychologique : la dépendance, la solitude, ou encore la souffrance des aidants. Grâce à cet éclairage, le film a pris une dimension encore plus concrète, rappelant que derrière la fiction, il y a des réalités vécues au quotidien.

Présenté à Cannes en 2012, Michael Haneke surprend en racontant une histoire d’une brutalité, non pas violente, comme ses autres films, mais plus intime : celle de la fin de vie. Nous suivons Georges et Anne, un couple âgé musiciens, dont la routine paisible bascule après un accident vasculaire d’Anne. A partir de là, le spectateur est enfermé avec eux dans leur appartement, comme dans une lente descente vers l’inévitable. Haneke ne cherche pas à faire pleurer : il nous force à regarder. Et c’est peut-être là que réside la vraie violence du métrage.
Le réalisateur joue avec le rythme pour déstabiliser. Les plans, souvent fixes et filmés en plans séquence, installent une attente insoutenable, comme si tout était au ralenti, et que la chose censée arriver n’arrive pas. Puis, sans prévenir, une coupe brutale, un geste violent, une scène courte : le spectateur est pris au dépourvu. Ce contraste crée un rythme perturbé, dérangeant, qui reflète le dérèglement que la maladie provoque au quotidien. A travers le huis clos, Haneke accentue l’enfermement du couple. L’appartement peut même être qualifié de personnage à part entière, qui devient à la fois un refuge et une prison. Après le retour d’Anne, la caméra ne sort plus jamais dehors : le monde extérieur disparaît. On vit littéralement avec eux, comme si Haneke nous enfermait aussi.
Cette immersion atteint son sommet dans les détails de mise en scène, apportant réalisme et intimité. Les plans larges et les surcadrages permanents isolent les personnages, tandis que l’absence totale de musique extradiégétique empêche toute émotion artificielle. La seule musique entendue est celle que jouent ou écoutent Georges et Anne, comme si Haneke refusait toute manipulation du spectateur. Ce refus de pathos s’accompagne d’un travail minutieux sur la lumière et les couleurs : les tonalités froides et sombres dominent, accentuant la gravité du sujet.
Quelques scènes “échappent” cependant à ce dispositif : le pigeon, qui traverse plusieurs fois l’appartement, “casse” l’ambiance oppressante : il peut représenter l’âme d’Anne, son désir de liberté, de ne pas vouloir vivre en étant malade, ou peut être simplement une manière pour Georges d’extérioriser son crime. Rien n’est imposé : plusieurs lectures coexistent, et c’est au spectateur d’y trouver sa propre version. Ces scènes, comme celle du rêve de Georges, échappent à l’aspect réaliste du reste du film : elles ouvrent une dimension onirique et métaphysique au récit.
Mais derrière ce réalisme presque documentaire se cache une question majeure : Georges tue-t-il par amour ? Le film n’y répond pas vraiment, c’est même le silence qui règne. Le geste final, à la fois tendre et terrible, condense toute l’ambiguïté du titre. A mon sens, l’amour devient un mot à double tranchant, capable d’unir autant qu’il détruit. Amour n’est pas un film sur la mort, mais sur ce qu’il reste une fois que tout est parti.
En refermant la porte de cet appartement, on ne sait plus très bien si Haneke nous a montré un drame, une histoire d’amour, ou un miroir. Peut-être les trois. Et peut être que, comme le pigeon, on ressort de là un peu sonné, mais libre.
Loïs Sagot, THORUS